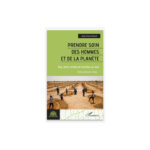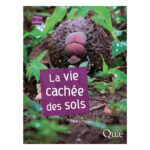600 kits envoyés pour le projet PlastiZen !
Découvrez l’interview des porteurs du projet PlastiZen, Arthur Compin et Camille Larue, coordinateurs du projet et Clémence Pierrard, animatrice du projet.
Question 1 : Pouvez-vous nous présenter le projet PlastiZen, sa mission et qui le fait vivre ?
C’est au sein du CRBE (Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement) que naît le projet PlastiZen, d’une impulsion du directeur qui souhaitait utiliser les outils de Sciences et Recherches Participatives au sein de la recherche.
Camille Larue et moi-même, Arthur Compin, tous deux chercheurs au sein du laboratoire, avons été désignés comme animateurs. Comme première action, en décembre 2020, nous avons réuni tous ceux qui le souhaitaient au labo, tous métiers confondus pour réfléchir au thème du projet à lancer et deux ont été retenus : le plastique et la dégradation des sols et l’impact sur la biodiversité. Le nom a ensuite été voté et c’est comme ça qu’est parti le projet !
Afin que cela reste transversal, tous les ateliers étaient ouverts à tous les membres du labo. Ils ont eu plus ou moins de succès en fonction du sujet. C’est lors d’un de ces ateliers qu’il a été décidé de confectionner des kits à envoyer. Les premiers sont partis en mai 2021, grâce à l’implication de stagiaires et services civiques !
Le projet a continué à se développer notamment grâce au soutien de la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS (MITI) qui a servi à :
- développer l’interface numérique et l’application du projet (Société Adict Solutions), qui a grandement déchargé l’équipe au quotidien
- s’associer avec une sociologue, Saliha Hadna, afin d’agréger des formulaires en début et fin de parcours pour observer l’évolution des participants et l’impact que ce projet a pu avoir sur eux.
Pour résumer, l’objectif du projet est de collecter de la donnée utilisable scientifiquement (est-ce que ces plastiques se dégradent et selon quels paramètres ?) et favoriser les relations entre scientifiques et membres de la société civile pour sensibiliser sur ce qu’est la recherche et comment on la fait ainsi que sur la problématique des plastiques dans l’environnement.

[Sciences et Recherches Participatives sur les sols et sciences humaines :
L’AFES a organisé, il y a quelques semaines, un webinaire sur les liens et synergies entre les disciplines, à revoir sur Youtube : « SRP : le choix des mots pour impliquer les humains. »]
Question 2 : Mais alors, initialement, comment est né le projet ?
C’est un projet pensé à l’échelle nationale mais commencé en région Occitanie, à Toulouse, qui a donc pris ses marques ici, grâce au réseau du laboratoire dont il est originaire, avant de prendre de l’ampleur dans d’autres régions, notamment en région parisienne grâce à un partenariat avec l’association “Fort Recup” à Aubervillier, mandaté en 2023 pour distribuer des kits en Île de France.
Nous cherchons à tisser des liens avec des acteurs relais comme des structures de communication scientifique tel que le DÔME à Caen actuellement, qui pourrait devenir aussi un relais sur la fabrication des kits.
Question 3 : Justement, qu’est ce qui se trame en ce moment au sein du projet et occupe votre temps dédié au projet ?
En plus du quotidien, de l’envoi de nouveaux kits et du traitement des données remontées par les participants, nous concentrons nos efforts sur le développement de la collaboration avec les écoles. Nous venons d’ailleurs de déposer un projet en réponse à l’appel à projets “Co-recherche avec la Société” de TIRIS. Nous avons fait le constat que beaucoup d’enseignants s’emparaient du protocole mais qu’il n’était pas adapté à ce public, tant dans le déroulé que dans l’accompagnement d’un groupe. L’objectif, avec l’obtention d’un financement, serait d’adapter le protocole existant au public scolaire en proposant un module supplémentaire parallèle à celui existant pour le grand public.
Toutes ces évolutions permettent de présenter le projet comme un outil pédagogique potentiel, pour sensibiliser un public jeune, différent de notre public actuel, majoritairement déjà sensible aux enjeux de protection des sols. Plusieurs liens ont déjà été tissés avec l’académie de Toulouse ou celle de Normandie dans laquelle nous lançons un projet pilote avec 16 écoles qui recevront le kit pour le tester. Avec les écoles, il sera aussi plus simple de proposer un kit avec plusieurs expériences, d’obtenir un retour des données plus automatique et d’ouvrir à d’autres protocoles en créant des partenariats avec d’autres projets de sciences et recherches participatives.

Question 4 : Si vous avez rencontré des difficultés, qu’ont-elles été et quels leviers ont été utilisés pour les contourner ?
Les difficultés qui ont pu être rencontrées sont de deux types, celles au niveau externe puis interne.
Nous avons un taux de retour des informations de 50 %, qui n’est pas à déplorer mais nous aimerions l’améliorer, grâce à l’application notamment qui a déjà fait ses preuves pour être “au plus près” des gens et pour les accompagner au mieux lors de “couac” dans le système (un matériel manquant ou autre, eh oui, cela reste un projet géré par des humains et qui transite par la Poste !) ou de difficulté à centraliser les données.
La question de la gratuité entraîne aussi forcément des émulations au début et un engagement décroissant au fil des mois du projet. Nous travaillons sur l’aspect du délai du retour d’informations aux participants après la collecte des données. Ce sont les enjeux du temps long de la recherche… Nous devrons être vigilant sur ce point avec les scolaires car cela devra bien s’imbriquer dans l’année scolaire et au programme !
De plus, notre projet traite la question du plastique et nous nous sommes efforcés au fil du temps de réduire la quantité de plastique envoyée dans le kit : moins de consignes plastifiées, moins de sachets en plastique…
Enfin, dans le cadre de ce projet participatif, nous pouvons rencontrer des enjeux en interne au labo pour mobiliser les troupes sur le long terme. Nous observons déjà que ce sont toujours un peu les mêmes personnes qui s’impliquent dans le projet après plusieurs années maintenant…
Question 5 : Et à ce jour, quelles sont les perspectives du projet ?
En plus du développement vers le public scolaire, nous continuons nos réflexions pour adapter la solution aux professions agricoles où les problématiques liées au plastique sont importantes : mise en place d’un protocole adapté et utile à leurs pratiques, création d’un kit de qualité des sols en étant encore plus ambitieux et en s’associant à des partenaires.
Si ces questionnements sont aussi au cœur de votre projet, n’hésitez pas à nous contacter pour y réfléchir ensemble !
Question 6 : Une donnée marquante qui ressort du projet depuis le lancement ?
Nous devons garder en tête que c’est à la base un projet scientifique qui doit prendre en compte une grande diversité de participants et peu de variables sont observées.
Sur les 600 kits envoyés, plus de 50 % des plastiques ne sont pas du tout dégradés visuellement en 3 mois d’enfouissement dans le sol. Nous ne nous attendions pas forcément à ça mais cela nous permet de souligner la grande variabilité de la biodégradabilité des plastiques dits “biodégradables”..

Question 7 : Pour finir sur une note positive, qu’est ce que ce projet vous apporte et qu’est ce qui en fait sa différence ?
La pluridisciplinarité ! Il nous a déjà ouvert plusieurs portes très intéressantes, celle de travailler avec un électronicien ou un développeur pour l’interface informatique mais aussi de rencontrer l’AFES ou le DÔME. C’est très gratifiant pour nous l’équipe cette transversalité des apprentissages. On participe à des activités en lien avec la société, on sort de notre laboratoire, on fait de la sensibilisation mais il ne faut pas perdre de vue la recherche qui attend un résultat pour le valoriser scientifiquement.
On est aussi fier de pouvoir contribuer, grâce à ce projet, au développement de projets d’avenir pour les services civiques qui ont pu intégrer l’équipe au fil du temps et continuer leur parcours en valorisant cette expérience.
Si vous voulez en savoir plus sur le projet, découvrez quelques résultats publiés et référencés sur le centre de ressources de l’AFES : https://www.afes.fr/ressources/les-sciences-citoyennes-pour-letude-de-la-degradation-des-plastiques-dans-le-sol-le-projet-plastizen/