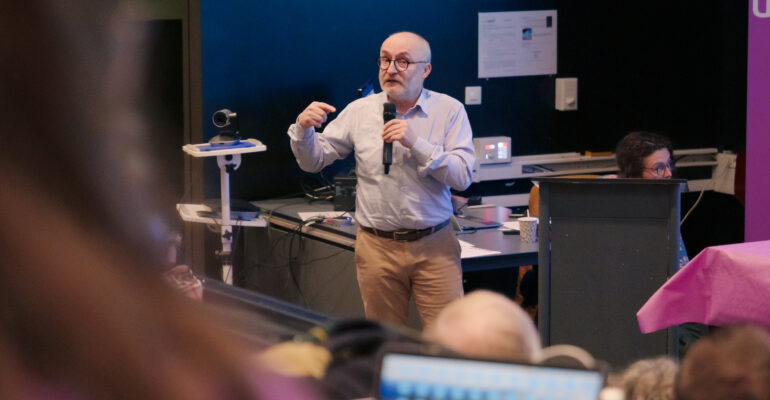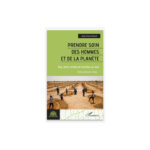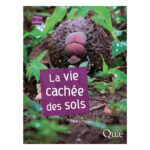Les sols et les lois
Journée Mondiale des Sols 2024 (Jeudi 5 décembre) – Table ronde & Échanges sur des politiques (stratégies, réglementations) existantes ou en construction aux échelles EU, FR et locale et les enjeux de leur mise en œuvre.
Le sol pâtit de son invisibilité juridique. Il n’existe pas en tant que tel dans le droit français. Pourtant, la loi ZAN parle de lui et la directive-cadre européenne fera de sa préservation une obligation à l’échelle du continent. Progressivement le sol devient un objet social, voire, un acteur politique.
PNR, ADEME et agences de l’eau : accompagner les élus dans la gestion des sols
Aujourd’hui les sols sont un sujet central. Il y a dix ans, on se comptait facilement et on se désolait. Les parcs naturels régionaux (PNR) en ont fait un vecteur de pédagogie. Chargés de réunir les élus et les représentants des usagers de leurs territoires dans un projet collectif, ils sont des organes de médiation, des Grenelle permanents où l’on débat du développement des patrimoines naturels, paysagers, culturels et artisanaux. « Notre souhait est de faire des sols une problématique à part entière, un élément transversal, » c’est-à-dire pas un sujet éclaté entre l’urbanisme, la voirie ou les espaces verts, défend Julien Chesnel, référent forêt de la fédération des PNR, et chargé de mission bois-forêt au PNR des Boucles de la Seine normande. « C’est important d’avoir les sols dans le cadre quand une charte [sorte de contrat entre les collectivités adhérentes, qui fixe les objectifs] est révisée, de façon à faire comprendre que les sols sont le support de presque toutes les activités. » Dans une note d’analyse coécrite en 2024 avec l’ADEME, on peut lire une illustration sous forme d’alerte : « Le déploiement des énergies renouvelables dans les territoires peut affecter la santé, la biodiversité et le maintien des fonctionnalités écologiques des sols. Les aires protégées, et tout particulièrement les Parcs naturels régionaux (PNR), peuvent jouer un rôle central dans la conciliation des enjeux de développement des EnR et la préservation des sols, d’autant plus qu’ils sont souvent identifiés comme des ressources foncières. » En clair, œuvrant à la bonne gestion d’immenses surfaces, les PNR veulent augmenter leurs compétences en matière de sols afin de ne pas se laisser emporter par la vague éolienne. C’est d’autant plus stratégique que, rappelle Julien Chesnel, « nous sommes personnes publiques associées, nous rendons donc un avis sur les documents d’urbanisme et de planification, » les Scot et les PLU. « Or, un avis peut donner lieu par les services de l’État à des demandes de modification… » Finalement, les PNR ont toujours eu les sols en tête, et le zéro artificialisation nette est de fait dans la logique des parcs naturels régionaux. La marche à prendre est désormais de faire des sols un pilier des chartes futures.
Dans cet objectif, l’ADEME a signé une convention avec la fédération des parcs, afin de « renforcer la gestion durable des sols et d’optimiser les actions de préservation, » nous dit Antoine Pierart, coordinateur Qualité des sols et Prospective. Le père de la Fresque du sol (avec l’Afes, la mère) déploie les efforts tous azimuts de son agence : réalisation de cartographies du potentiel de stockage carbone dans les sols (outil Aldo), participation aux grands réseaux que sont le GIS sols et le RMQS, travaux de prospectives, développement d’un service numérique dédié aux élus souhaitant rafraîchir leurs villes (Plus fraîche ma ville), « on est également sollicités pour donner notre avis au sein des conseils régionaux, notamment à propos de notre prospective 2050 dont nous travaillons à des déclinaisons régionales », déjà faites pour la Bourgogne-Franche-Comté. L’axe majeur reste la fameuse Fresque du sol, un succès : 200 animateurs ont déjà formé 8 000 participants, dont des agriculteurs. « On fait aussi beaucoup de sciences participatives, notamment avec l’opération plante ton slip ! », ou comment apprendre la vie des sols en plantant un slip (si possible en coton bio et blanc) et en envoyant la photo de ce qu’il en reste deux mois après.
Autre acteur politique majeur des sols, les agences de l’eau. Comme l’ADEME, elles financent maintes actions en faveur des sols pour améliorer la qualité de l’eau. La protection des aires de captage, le reméandrement d’une rivière, la restauration d’une zone humide, la plantation d’une haie agissent sur l’eau par les sols. En ville, l’agence de l’eau Seine-Normandie a développé « la plateforme Turbeau, afin d’aider les élus à intégrer l’eau dans les documents d’urbanisme, » explique Quentin Duval, chargé de projet Eau et urbanisme à l’agence. Sur le site, un parcours guidé amène les élus et autres chargés de mission à trouver d’eux-mêmes les documents nécessaires à leurs projets. « On fait ainsi en sorte que les Scot et les PLUi soient compatibles avec les Sage, » les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau à l’échelle des petits bassins-versants.
En résumé, les parcs naturels régionaux, l’ADEME et les agences de l’eau collaborent pour connaître, comprendre, mieux protéger et gérer les sols, dans l’espoir de rendre compatible avec eux le développement des territoires.
Scot-sols à Chambéry
Thibault Guigue, président de Métropole Savoie, a bien compris l’importance des sols et leur lien avec l’eau. Ce syndicat mixte, qui gère le Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) de 107 communes, a placé les sols au cœur de sa révision en 2022. « On a mis les sols au centre de la révision de notre Scot, en répondant à un AMI [appel à manifestation d’intérêt] de l’ADEME en 2022, qui appelait à réfléchir à la multifonctionnalité des sols (carbone, biodiversité cycle de l’eau, biodiversité), » selon la méthode MUSE mise au point par le Cerema dans le but, dixit celle-ci « d’aider les collectivités à mieux prendre en compte la qualité des sols dans leurs documents d’urbanisme en lien avec les enjeux et les besoins de leurs territoires. » Pour ce faire, essayer de caractériser les sols sur la base des fonctions qu’ils sont en capacité de remplir et d’adapter leur usage en privilégiant la préservation de ces fonctions et leur mobilisation dans le projet de territoire.
Le syndicat mixte a donc lancé des études pédologiques couplées à des études d’urbanisme sur quatre sites d’intérêt, pour voir l’intérêt de la méthode : une zone d’extension rurale, deux espaces de requalification urbaine en périphérie de Chambéry et d’Aix-les-Bains, et un espace à aménager au sud de Montmélian. Essais réussis. Essai prolongé, car « en, 2026 on accompagnera financièrement les communes dans leurs études d’urbanisme, pour qu’elles intègrent toutes un volet pédologique. »
Thibault Guigue est convaincant car il est convaincu. Il est même… d’avoir mis en pratique une aspiration qu’il avait lorsqu’il était étudiant. Qui a été encouragée dans un territoire dont les élus en majorité issus du monde agricole ont toujours eu le souci des paysages : l’urbanisation a été réduite de moitié entre 2005 et 2020. Étonnamment, le zéro artificialisation nette (ZAN) inquiète ces mêmes élus, qui ont peur de ne plus être maîtres chez eux, soumis qu’ils seraient de décisions venues d’en haut. C’est alors qu’on découvre l’intérêt politique de la prise en compte des sols : elle permet aux élus d’arbitrer sur des bases solides, de donner par exemple des arguments irréfutables lorsqu’il faut expliquer à des propriétaires pourquoi leurs parcelles ne seront prochainement plus constructibles. Prochaine étape : croiser la gestion des sols avec celles de l’eau et du tourisme hivernal. Un défi que ce montagnard aborde avec optimisme.
À Rouen, la multifonctionnalité guide le PLUi
Allons plus loin avec Marlène Minor, qui est une figure rare en France : elle a été embauchée pour intégrer les enjeux environnementaux, dont les sols, dans la révision du Scot et du PLUi de la Métropole de Rouen. « Le périmètre des deux est identique à celui de la Métropole, ça aide. » Contrairement à Chambéry, Rouen et ses 71 communes sont déjà engagées vers le zéro carbone en 2050, et bien que certains élus soient encore sceptiques, le ZAN ne les effraie pas trop.
Son rôle a été de briser les silos entre les différents services de la collectivité. « on m’a demandé de mutualiser les besoins de la collectivité, pour ne plus travailler en silo, chacun dans son service. », explique Marlène Minor-Enot. En tant que responsable des sols, du ZAN et de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser), elle facilite les échanges entre les équipes répartis en multiples services qui travaillent de près ou de loin sur la planification urbaine. Selon elle, « les sols, c’est en fait moins compliqué à expliquer que le ZAN. Des élus ont du mal à se projeter, à savoir comment arriver à l’objectif de zéro artificialisation nette. Alors qu’avec les sols, on parle agriculture à des maires qui sont ou ont été agriculteurs, ils comprennent intuitivement la notion de potentiel agronomique dans la multifonctionnalité. »
Elle a ainsi fait établir une carte des différentes fonctions du sol couvrant l’ensemble de la métropole. Au départ, elle s’est elle aussi inspirée du projet MUSE, puis elle a rencontré le pédologue et maître de conférences à l’université de Caen Patrick Le Gouée (également impliqué dans Vigisol) « qui m’a dit que l’échelle de Muse, 1/250000e, ça n’irait pas, qu’il fallait aller au 1/50000e. » Patrick Le Gouée n’a pas sorti le chiffre de son chapeau : « Dans les années 1980, le ministère de l’agriculture avait déjà poussé les départements à élaborer des cartes des terres agricoles à cette échelle, mais cela s’est vite arrêté, en Normandie, on a une dizaine de cartes seulement. »
Il faut dire qu’une carte des sols est complexe à construire. Il faut d’innombrables coups de tarières qui, « en soi, ne représentent pas grand-chose : 30 cm2, sur 1 ha égale 1 milliard de centimètres carrés, ce n’est rien, alors il faut interpoler. » Le prélèvement, mouliné avec la topographie, la géologie, l’occupation des sols, le climat, l’histoire géomorphologique, l’histoire de la parcelle etc. « On combine tout cela, et on pondère car tous ces facteurs n’ont pas le même poids selon l’endroit où on se trouve. » Avec une marge d’erreur qui diminue à mesure que l’on accumule les prélèvements, les données. Cette démarche hypothéticodéductive nécessite d’avoir un rapport intime à l’espace. De connaître le terrain. Elle aboutit à une sorte de « livret de famille » des sols, selon l’expression du pédologue.
« En fait, l’échelle dépend de l’enjeu. Pour Rouen, il s’agissait de réviser le PLUi et le Scot, alors il fallait une échelle plus fine. Pour cela, on a fait 1 000 sondages de sols, dont 30 fosses pédologiques. » Mis en musique, l’ensemble des données dessine aujourd’hui des cartes de fonctionnalité des sols, où chacune (celles de Muse, capacité d’infiltration de l’eau, potentialité agronomique, stockage du carbone, biodiversité) apparaît notée – et colorée – de 1 à 5. « Le résultat tangible est qu’après combinaisons des notes, on a pour chaque endroit une note de multifonctionalité, également de 1 à 5. » Pour les élus, cela permet de visualiser directement les conséquences de leurs choix, ce qui les aide à prendre des décisions mieux éclairées pour le futur de leur territoire.
Le sol n’a pas de droit
Thibaut Guigue et Marlène Minor sont presque des ovnis en France car il existe très peu de collectivités qui ont réellement intégré dans leurs plans d’aménagement les sols en tant que compartiment au même titre que l’eau. Ils ont du mérite, car rien en France n’oblige vraiment à y faire attention : le sol n’a toujours pas d’existence juridique, c’est ainsi. Professeur agrégé de droit public à la Faculté de droit de l’Université Jean-Moulin – Lyon 3 et directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon, Philippe Billet le déplore. « Le sol se cache sous des dénominations diverses, il est une interface, un support de la propriété immobilière, un territoire, un fonds ou un tréfonds, il n’y a pas de prise en considération explicite de sa qualité de milieu naturel, » ou de sa naturalité contrairement à l’eau et à l’air qui, eux, ont leurs places dans le code de l’environnement. En droit français, le sol n’existe que s’il sert à quelque chose en tant que support (de plantes, de vaches et d’immeubles), filtre (pour l’eau), vecteur de risques (érosion, pollution) ou stockage (de carbone, d’eau). « Le sol ne fait que concourir au patrimoine commun dans la loi climat et résilience de 2021 de la biodiversité, » le sol aide donc, il ne fait pas partie. Cette même loi lutte contre l’artificialisation, avec l’objectif ZAN qu’elle fixe. Le sol y est présent, comme il l’est de manière subliminale dans la définition d’un Scot, rappelle Philippe Billet (le Scot « … justifie les objectifs chiffrés de limitation de [la] consommation [d’espace] compris dans le document d’orientation et d’objectifs »), et d’un PLU. Le sol est là sans être là, toujours de manière utilitaire : « dans un PLU, le zonage traduit une vision politique de l’occupation des sols, souvent découplée de la réalité de son intérêt écologique, » même si la loi ALUR de 2014 a introduit le coefficient de biotope, défini comme étant la part de surface végétalisée ou favorable au fonctionnement de la nature sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction. Concrètement, n’en déplaise aux élus qui disent ne rien pouvoir faire pour préserver les sols agricoles, un arrêt du Conseil d’État de 2020 précise qu’il est possible de classer en zone A (agricole) certains terrains pourtant artificialisés afin d’éviter que la surface artificialisée soit étendue et de lutter contre l’effet tâche d’huile, au grignotage progressif des parcelles agricoles contiguës. En outre, rappelle Philippe Billet, « il est possible de considérer les zones AU [à urbaniser] qui n’auront fait l’objet d’aucun projet d’aménagement ou d’acquisition foncière au bout de 9 ans comme zones naturelles ou agricoles. Elles ne pourront donc plus être ouvertes à l’urbanisation, sauf révision du PLU. » Les maires peuvent donc préserver les terres agricoles, sans attendre la directive-cadre européenne qui a un objectif qui les intéresse directement : définir clairement la notion d’artificialisation et suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de non-artificialisation nette de terres. Pour les agriculteurs, le projet va loin, car il « introduit un certificat de santé des sols pour les transactions foncières, afin de fournir aux acheteurs de terrains des informations sur les principales caractéristiques et la santé des sols du site qu’ils ont l’intention d’acheter. » Demain, le prix de vente des terres adossé à la qualité objective des sols ?
L’Europe change le cadre
Proposé le 4 juillet 2023 par la Commission, adoptée le 10 avril 2024 par le Parlement, le projet de directive doit encore être voté. « Il y a eu, à ce stade, un recul de la composante pro environnementale », reconnaît Christian PROBST, administrateur principal au sein de la DG Environnement de la Commission Européenne. Dans ses grandes lignes, la directive prévoit de donner une définition légale de la bonne santé des sols, de fournir aux États membres un cadre pour les gérer durablement et de réhabiliter les sols pollués. Pour cela, elle veut imposer aux États membres de collecter des données sur l’état de leurs sols, y compris des données sur la vie biologique. Ainsi, chaque sol de l’Union se verra attribuer ce certificat de santé équivalent à une sorte de DPE énergétique, qui signalera son état écologique : élevé, bon, modéré, dégradé et gravement dégradé, les deux premiers niveaux considéreront les sols sains.
« On en est à essayer de se mettre d’accord sur un texte final entre le parlement et la Commission. » C’est long, parce que l’ambition de long terme – protéger les sols en tenant compte de leurs qualités objectives – est portée par une démarche graduelle, histoire de ménager les susceptibilités. « Il y a une inquiétude exprimée par le Parlement liée à la crainte que la directive engendre une charge nouvelle et des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs, » les aménageurs, les élus et tous les usagers des sols. C’est vrai que la directive implique une formidable connaissance des sols qui engendrera inévitablement des procédures à respecter, des déclarations à faire, des registres à nourrir et des contrôles à accepter.
Les diagnostics ? Non, à moins que…
Ce qui embête Sébastien Windsor, président de Chambres d’agriculture France. Il le dit tout de go, « je ne veux pas de diagnostics sols, » car cela alourdirait encore un peu plus la charge administrative déjà massive des agriculteurs, sans parler de la charge financière : qui va payer ? Autre point de blocage, l’accompagnement. « C’est bien de passer des heures à établir des diagnostics, d’aller très dans le détail, mais pendant ce temps-là, on n’est pas forcément avec l’agriculteur pour l’accompagner dans un changement qui est bien plus global. » Selon le président des chambres, ce sont les plans d’action qui comptent afin de valoriser le travail de l’agriculteur. Les uns n’empêchent pas les autres, cela dit : on peut faire des diagnostics, et en parler ensuite aux paysans avec des plans d’action. « Les agriculteurs font déjà des diagnostics, sur les reliquats d’azote par exemple. Mais derrière il y a un conseil, un plan d’action et un financement. ça devrait être pareil pour un diagnostic matière organique ! » qui n’est pas obligatoire mais le deviendrait avec la directive européenne. Sébastien Windsor n’est finalement pas contre les diagnostics, à condition, comprend-on, qu’ils soient livrés avec un SAV et un financement. D’autant qu’il défend l’idée que les sols sont devenus le facteur limitant de l’agriculture, que de l’état de leurs « microbiotes, » selon son expression, dépend l’expression de certaines maladies des plantes. Pour autant, insiste-t-il, est-il besoin de réglementations supplémentaires ? « On a refusé le projet de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy parce qu’il arrivait avant que la directive-cadre ne soit bien connue, ça allait servir à quoi, une nouvelle réglementation sans connaître la suivante ? » Lui-même producteur de céréales, de betteraves, de lin, de féverole, de maïs et de porcs en Seine-Maritime, Sébastien Windsor prône un retour à l’agronomie dans les champs, que semble partager le monde paysan qui dans l’ensemble laboure moins et développe les intercultures, pour ne plus laisser les sols à nu et les enrichir d’azote capté par les légumineuses. « L’agronomie ne se résume pas à des diagnostics de sols, on sait faire sans ! » plaide-t-il. À condition que les exploitants soient réellement aidés à changer de système s’il est avéré que le leur épuise, et non pas simplement à modifier leur assolement. Bref, les diagnostics c’est non, sauf s’ils participent d’un accompagnement en profondeur et à long terme du monde agricole.
Président de la fédération. nationale des Safer et élu à l’urbanisme en sa bonne ville de Gisors, Emmanuel Hyest partage la vision des choses de son collègue Windsor. « Si c’est pour faire des DPE, ça ne sert à rien, et ça surenchérira le coût du foncier. Le foncier agricole est à 6 000 euros en moyenne l’hectare, si vous avez 800, 1 000 euros de diagnostics, ça ne vaut pas le coup ! » La fourchette est peut-être un peu exagérée, il n’en reste pas moins que les analyses biologiques coûtent cher, et que la facture piquera l’agriculteur qui voudra vendre. La solution est déjà connue : les coûts seront intégrés, et feront augmenter les prix de vente des terres. Au bénéfice de qui ? « Si c’est pour nourrir une start-up, non merci ! » ironise Emmanuel Hyest. Les diagnostics étant inévitables, nombre de bureaux d’études se sont positionnés sur un marché à venir qui ne peut qu’exploser. Quelles seront leurs compétences, dans la mesure où nombre de chercheurs ont remarqué leurs défauts de formation en matière pédologique ? Qui plus est, ajoute le président de la fédération nationale des Safer, qu’il y a selon lui un biais de jugement : « on va étudier la microbiologie des sols, c’est très bien… mais quelle est la responsabilité d’un exploitant sur les microbes qu’il a dans son sol ? Personne n’est capable de le dire, » et l’agriculteur actuel risquerait d’être puni par une faible notation pour les mauvaises pratiques des agriculteurs qui l’ont précédé.
Emmanuel Hyest n’est pas un grand supporter de ce que l’Europe prépare, par contre, il défend mordicus la loi ZAN. Il souligne, avec l’assentiment de Sébastien Windsor, que le ver de la dérogation est dans le fruit de l’affaiblissement réglementaire depuis la suppression de la taxe d’habitation par Emmanuel Macron en 2017 : les seules ressources financières propres des collectivités n’étant plus que les impôts liés au foncier, il faut aménager de nouveaux espaces. Bref, remettons la taxe d’habitation. Autre problème, car l’agriculture et l’immobilier sont liés dans la concurrence pour une ressource rare, le sol, « on a choisi en France un modèle de grands constructeurs plutôt que d’artisans qui rénovent. On construit forcément du neuf, on ne réhabilite et on ne réutilise pas l’existant : résultat, la vacance est énorme ! » Les terrains à bâtir de demain devraient être les terrains déjà bâtis. Et tout cela devrait être réfléchi à l’échelle un EPCI, un regroupement de communes, auxquels les Scot devraient être circonscrits.
Transition foncière
L’Institut de la Transition Foncière est une association qui veut – c’est sur son site – « replacer la préservation des sols vivants au centre des politiques publiques et des activités des entreprises, tant dans les milieux liés à l’aménagement et à la construction que dans la société civile. » L’ITF réunit dans cet objectif collectivités, associations, entreprises, organismes de recherche et divers opérateurs publics et forme, assure des expertises et réfléchit à des prospectives. Margot Holvoet en est la déléguée générale. « Ce serait bien qu’on sorte du débat sur le ZAN qui devient stérile. En sortir par le haut par une politique des sols, via une coalition sur le sujet : avoir par exemple une délégation interministérielle aux sols pour avoir une cohérence publique », afin d‘aboutir, Margot Holvoet ose, une loi d’orientation des sols. Carrément. Une loi qui reprendrait cette bonne idée qu’est le DPE sols, telle qu’il apparaît dans le projet de loi avorté de la sénatrice Bonnefoy, tel qu’il advient dans celui de la directive-cadre européenne. En attendant, l’Institut met en valeur les territoires qui ne sont pas réfractaires au ZAN, comme la région Bretagne, le département de Loire-Atlantique et la Métropole de Lyon « qui ont mis en place un principe tout bête : ils participent financièrement seulement aux projets en renouvellement urbain et pas en artificialisation. » À chaque fois, une volonté politique forte a assumé le soutien à la loi ZAN. D’autant plus facile peut-être que l’évolution de la loi a fait que l’enveloppe dérogatoire de foncier artificialisable a gonflé avec les projets d’envergure nationale (PEN). Enveloppe que les régions distribueront aux EPCI dans le cadre de leur Sraddet (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Dans un contexte où la multiplication des inondations a fait dire même aux ennemis jurés du ZAN – David Lisnard et Éric Ciotti par exemple – que préserver des sols pour éponger les pluies n’était pas une idée sotte. Mais voilà, calcule Margot Holvoet, « on fait de la surenchère avant les municipales de 2026, pour ne faire peur à personne. »
Les élus ne sont pas toujours contre le ZAN par principe. Ils le deviennent lorsqu’ils constatent que l’application du ZAN nécessite une expertise technique qu’ils n’ont pas en stock parmi les chargés de mission. Les collectivités devraient elles aussi être mieux accompagnées, au moins pour ne pas avoir peur… des sols. Voilà pourquoi l’Institut de la transition foncière fabrique des outils pour évaluer la sobriété… foncière, « la construction sur des friches coûte aujourd’hui plus cher que de construire sur de la terre agricole. Alors, on a mis au point un tableur qui permet de chiffrer la dette écologique à artificialiser : on évalue l’état de quatre fonctions écologiques des sols, on fait une projection pour voir où en seraient ces fonctions après l’opération immobilière, et on obtient le chiffre-clé, le devis de renaturation, » c’est-à-dire le coût de réparation à long terme de la diminution des services rendus par les sols. Une manière de renchérir le coût des projets, de flécher les subventions vers les « bons » projets, et d’aller chercher des recettes en renaturation, pour ne pas dire compensation. Un outil qui intéresse justement les banques de compensation écologique ou carbone. « On prône aussi des études de préfiguration de ce que pourrait être un diagnostic sols, quelles techniques employer, combien il faudrait de passages de bureaux d’études, le coût global et par qui il devrait être supporté. » De quoi préparer l’inévitable avènement des sols ?
Par Frédéric Denhez