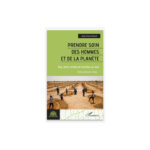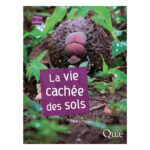Quelles données, pour quoi faire ?
Journée Mondiale des Sols 2024 (Mercredi 4 décembre) – Table ronde 2 : Capitalisation et utilisation des données sols agricoles : quels enjeux ?
Consentement et valorisation des données sols
La collecte et l’exploitation de certaines données sur les sols est déjà centrale dans le travail des agriculteurs. La gestion de la fertilisation dépend d’elles. Demain, c’est l’ensemble des itinéraires et des ateliers qui reposeront sur des données objectives tirées de l’analyse des sols. Il est essentiel que les agriculteurs comprennent et acceptent cette évolution, qu’il n’aient pas le sentiment d’être contraints par une politique de surveillance. Thierry Chasles, Vice-Président de la SAFER Normandie souligne que les agriculteurs fournissent des données et doivent aussi en retirer des bénéfices, que ce soit par une meilleure gestion de leurs terres ou une valorisation foncière.
L’importance de la structuration des données
C’est entendu, il va falloir que les sols parlent. Qu’ils nous disent dans quel état ils se trouvent, à partir de quoi l’on pourra délivrer quelques idées de remèdes au monde agricole. Car le jour viendra, entend-on dans les colloques, où le prix de vente des terres, voire, le fermage, et même, les subventions dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), sera adossé sur la bonne évolution de certains indicateurs de qualité. Ce sera le temps où les agriculteurs paieront pour générer de la donnée, qui sera utilisée par d’autres. En réalité, ils le font déjà. Eux et les chercheurs, les aménageurs, les bureaux d’études qui travaillent de près ou de loin sur les sols. « La simple accumulation de données ne suffit pas, l’essentiel est de savoir quelles données sols utiliser pour répondre à quelles problématiques », résume Antonio Bispo, Directeur de l’unité de Recherche Info & Sols de l’INRAE, à Orléans. Quelles données, à quelle échelle, avec quelle précision, pour en faire quoi ? Comme l’avait énoncé Harmonie Brissaud lors de la table ronde précédente, il ne faut pas tomber dans le paradoxe du sachant qui finit par décrire son propre monde, pour son propre intérêt. « Il y a déjà des réseaux de mesures à différentes échelles, européennes, nationales, locales, l’important est de les organiser, et de sensibiliser à l’utilisation de leurs données, » y compris les bureaux d’études, qui, à entendre Antonio Bispo et avec lui nombre de chercheurs, ont parfois des lacunes étonnantes et donc, des biais de jugement.
Antonio Bispo gère le Groupe d’intérêt scientifique sol (GIS Sol), qui fédère quatre programmes complémentaires : l’Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS), le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) et la Base de Données des Analyses de Terre (BDAT) et la collecte nationale d’analyse des Éléments Traces Métalliques (BDETM). Sa collègue Joëlle Sauter, responsable de l’équipe « sols et fertilité » à la chambre régionale d’agriculture Grand Est s’occupe d’un autre réseau, le RMT Sols et territoires. Ce réseau mixte technologique a pour objectif d’améliorer la connaissance des sols et de leur multifonctionnalité, et de faciliter l’utilisation de l’information sur les sols par leurs usagers. « On cherche à améliorer le traitement de l’information pour la rendre utile, valorisable, » facile à appréhender. Il y a encore des efforts à faire car le site du RMT est assez touffu. « Il faut simplifier l’accès à la donnée sol », dit-elle en chœur avec son collègue de l’INRAE, « notamment avec le ZAN [loi zéro artificialisation nette]. De plus en plus de métiers demandent d’avoir accès à des données sols qui sont aujourd’hui éparpillées. » Qui plus est, elles sont le plus souvent livrées brutes de fonderie. Joëlle Sauter : « il faut les ouvrir, faire des cartes thématiques nationales [ou locales] qui permettraient de renseigner par exemple la profondeur des sols. »
En effet ! « La donnée brute n’a d’intérêt que si elle est mobilisée par un projet d’études, un usage. Pour cela, on ne peut pas s’affranchir d’une connaissance scientifique incontournable. Autrement, la donnée peut être dangereuse : on peut lui faire dire n’importe quoi. » », avance Daniel Delahaye, enseignant-chercheur de géographie et géomorphologie à l’université de Caen, et membre du GIEC normand. « Elle n’a Recueillir de la donnée c’est bien, mais comment la présenter sans introduire des biais de jugement ? Il faut des médiateurs, des formateurs, une ingénierie pour la traiter et aussi la présenter. « Multiplier les webinaires, les master classes, tout un tas de formats qui permettent aux jeunes aménageurs de continuer à se former. » Peut-être seront-ils aidés par ce futur poste d’aiguillage : une plateforme commune e-sol est en cours de création, qui regroupera le GIS, le RMT et les deux autres réseaux français qui s’occupent des sols, l’Association Française pour l’Etude du Sol (AFES) et le RNEST (Réseau National d’Expertise Scientifique et Technique sur les Sols). Un des objectifs est de contribuer à la formation des spécialistes des sols, qui commencent à manquer, en France, alors qu’il n’existe plus de formation doctorale en pédologie. Déjà, un recueil pédagogique de 25 séquences pour enseigner les sols a été publié, à destination des formateurs.
Aides à la décision
Au sein de Chambres d’agriculture France, comme on dit aujourd’hui (avant, c’était l’assemblée permanente des chambres d’agriculture), André Masseran observe. Responsable du service « Produits et services numériques » il développe des aides numériques pour les exploitants :
Il a notamment développé des solutions comme Mes parcelles :un site permettant de déterminer les types de sols d’une exploitation grâce à un questionnaire adapté à la localisation géographique.
Pas de tarières ni de spectro en infrarouge proche, une série de questions. Cela dit, sur Mes Parcelles on trouve aussi MesSatimages, une application de diagnostics biomasse et azote basée sur les images satellites de la parcelle. « Cela fait 20 ans que Mes Parcelles existe, on a intégré les types de sols depuis quatre ans. » Le système peut aussi ingérer les résultats d’analyses de sols (géolocalisés) mais aussi l’historique des cultures sur les parcelles pour mieux apprécier le « raisonnement » en potassium et phosphore. Avec 42 000 utilisateurs, Mes Parcelles est un succès. Relativisé par leur répartition, liée « au dynamisme commercial de nos conseillers ! »
Thierry Chasles est retraité agricole, président du comité technique départemental de la Safer dans la Manche, et vice-président de la Safer Normandie. Laquelle, présente-t-il, fournit depuis quelques années un outil d’aide à la décision fameux, car efficace : Vigisol, un programme unique en France d’observation de la consommation des sols à l’échelle de la parcelle. Au moyen de photos aériennes au 1/2000e avec zoom au 1/500e, Vigisol propose depuis 2011 aux élus et au monde agricole de quantifier les surfaces consommées, de qualifier les usages avant et après afin de suivre l’évolution du rythme d’urbanisation. Une réussite unique en France, car depuis que Vigisol existe, l’artificialisation baisse en Normandie et le mitage a à peu près cessé. D’avoir mis sous les yeux des élus les cartes précises des sols de leurs communes, et les conséquences de leurs décisions les auraient rendus plus prudents.
La solution de l’arbre
On voit là que la donnée sert à quelque chose de tangible. Cela pose en miroir la question suivante : à quoi bon avoir des données sous les meilleures formes, les plus compréhensibles, si on ne sait pas quoi en faire ? Les paramètres de la vie dans mes sols sont ce qu’ils sont, comment je peux faire pour les améliorer se demande l’agriculteur. « L’arbre ! » répond. « Il améliore le statut de la matière organique dans les sols, car il diminue l’effet des vents séchants et donc, il améliore le maintien de la réserve utile en eau. » Vieil objet de regrets et de rancunes, l’arbre paysan, la haie, revient tout doucement dans les campagnes. Il coûte cher à implanter, il nécessite une ingénierie importante. « Dans le sud du département, dans les PNR normands on voit quand même des agriculteurs reboiser leurs prairies quand ils arrivent en fin de carrière. » Une forme de capitalisation du bois, qui pourrait faire revenir la haie là où elle était avant le remembrement. La haie a plein de mérites que connaissent bien les agriculteurs, mais pourquoi s’embêteraient-ils à en aligner des hectomètres quand la constitution des dossiers de financement prend plus de temps qu’il n’en faut pour obtenir une dérogation pour arracher un bout de haie existante ? « De manière générale, la profession agricole est réticente, il y a un problème de rapport au temps long nécessaire – 10 à 20 ans – et beaucoup d’atermoiements politiques. » Il faut être très motivé pour planter des haies qui ne rapportent au mieux que 7 euros l’hectare de subvention PAC, et nécessitent de trouver une filière d’utilisation du bois pour en couvrir au moins les coûts d’entretien. « Altérer la fertilité d’un sol c’est rapide, alors que redonner sa fertilité à un sol, c’est beaucoup plus long. Mais il ne faut pas croire pour autant que les agriculteurs ne connaissent pas leurs sols, au contraire, ils en ont une vraie connaissance. » Ils devinent l’intérêt de garder des arbres, des alignements et des haies, et ils ont raison : toutes les données sols le démontrent. Ne serait-ce que la diminution du risque d’érosion, un des sujets d’études de Daniel Delahaye.
L’utilisation des données sur les sols est un enjeu crucial pour l’avenir de l’agriculture. Toutefois, leur collecte et leur interprétation doivent être mieux organisées afin d’apporter une véritable valeur ajoutée aux agriculteurs Ils doivent être associés au processus de collecte et de traitement. Ils doivent être informés des résultats, et des modifications de conduites de culture ou d’élevage que cela implique. Le développement d’outils numériques comme les logiciels d’aides à la décision ou les prises de vue satellites ou par drones, la mise en place de plateformes d’information et la reconnaissance par la recherche, les instances agricoles et la réglementation des pratiques favorisant la conservation des sols, telle que l’agroforesterie, forment ensemble un chemin prometteur vers un usage pertinent et efficace des données sols.
Par Frédéric Denhez