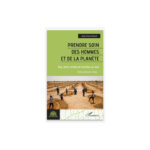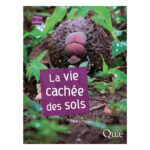Faire des diagnostics de sols chez les agriculteurs
Journée Mondiale des Sols 2024 (Mercredi 4 décembre) – Table ronde 1 : L’acquisition de données sur les sols en agriculture : quels enjeux ? Quelle participation des agriculteurs ? De la société civile ?
Il est question de demander aux agriculteurs un bilan de santé de leurs sols. C’est dans l’air du temps qui circule entre les bureaux de la Commission européenne. On en parle au Sénat, dans les syndicats agricoles, à la fédération nationale des Safer. Les agriculteurs, par réflexe, résistent. Pour les convaincre, une seule solution : travailler avec eux.
« Quand on regarde la matière organique entre Cherbourg et Dreux, on est assez inquiet. Depuis vingt ans ça baisse, par exemple dans le pays de Caux et en plaine de Caen. En fait, on a de moins en moins d’élevage, on travaille plus les sols et on met trop d’engrais. » Ce n’est pas un écolo qui parle, c’est Jean-Philippe Chenault, le référent Sol et fertilisation à la Chambre d’Agriculture Région Normandie. Depuis des décennies les agriculteurs normands font des analyses, et depuis des décennies, les analyses fournissent à peu près les mêmes enseignements : « les fondamentaux sont les mêmes », en Ca, P2O5, K2O et pH, tout est stable. En apparence, car Jean-Philippe Chenault déplore un manque de données, « tous les 5 ans, les agriculteurs devraient faire une analyse de leurs sols, ils ne le font pas assez, alors que ne coûte pas cher [entre 40 et 50 euros]. » Qu’en sera-t-il lorsqu’ils se mettront aux analyses physicochimiques et biologiques complexes, cinq à six fois plus coûteuses ? « Il y a de plus en plus d’indicateurs disponibles pour quantifier la matière organique, la qualifier, la fractionner…mais on n’a pas toujours une grille de lecture simple pour transformer tous ces indicateurs en conseils simples auprès des agriculteurs, » d’autant que l’hétérogénéité est importante en Normandie. Beaucoup de sols différents, parfois sur une même parcelle.
Les sols sont un acteur avec qui il faut désormais compter. Les chambres d’agriculture ont collectivement créé un « groupe métier national » avec 29 référents en régions, comme M. Chenault, lesquels s’appuient sur 2 animateurs, 34 pédologues 90 conseillers spécifique spécifiques et 382 conseillers occupant une fonction en lien avec le sol. Tout ce joli monde travaille sur des projets de recherches avec l’INRAE et l’ADEME, entre autres. Si un jour un diagnostic de qualité biologique des sols venait à être imposé, les chambres au moins sont déjà prêtes.
Des indicateurs pour indiquer quoi ?
La réponse semble résider dans la question : les enjeux sont énormes, les agriculteurs doivent participer, et pourquoi pas la société civile, c’est-à-dire, vous lecteur et moi, auteur. Il y avait des agriculteurs dans la salle pour cette table ronde de l’avant-dernière journée des JMS édition 2024. Nous étions à Caen, au Dôme, qui n’est pas un dôme. Maraîcher, Guillaume Haelewyn est aussi vice-président de l’association des décompactés de l’ABC, ce qui donne un avant-goût de ses propos : les décompactés de l’ABC est un mouvement qui met en œuvre et promeut l’agriculture biologique et la conservation des sols, en même temps. « Dans notre cas, acquérir des données ne serait pas très utile, car nos sols fonctionnent bien, » soutient Guillaume Haelewyn, car ils sont riches en matière organique : depuis qu’il s’est installé, l’agriculteur de la ferme des Deux Mains a constaté une hausse du taux de matières organiques de ses sols de 2,3 à 8. Sans utiliser d’engrais minéraux, bien entendu. « On travaille sur sols vivants, » un bien grand mot. A-t-il transformé ses terres en crèches à lombrics ? « Non, on a fertilisé par le paillage, c’est-à-dire de l’herbe de tonte, de la paille, des copeaux de bois, du compost de déchets verts. Et puis un peu de fiente de poule, » et quelques lisiers provenant de l’exploitation des parents de M. Haelewyn, des producteurs de lait. Pour dire comme lui, ses sols ont bien à bouffer. Et à boire, car « le paillage permet d’améliorer nettement la structure et la capacité de rétention en eau des sols. » Toutefois, il faut savoir s’arrêter car si la matière organique augmentait encore, elle attirerait les adventices qui se mettraient à prospérer. Ou alors il faut bien choisir son paillage en fonction de ce que l’on plante et de comment l’on cultive. « Une année, j’ai récupéré du fumier d’un haras, j’en ai étalé sur 20 cm d’épaisseur, on a planté des courges. Les limaces ont tout bouffé ! En fait, la paille avait laissé passer l’eau, et comme il n’y avait aucune plante hormis la courge, l’eau est restée, j’avais rendu mon sol hydromorphe, ce qui avait favorisé les limaces. [FD : j’en sais pas plus !] » Des plantes associées auraient sans doute pompé assez d’eau pour décourager les invertébrés
Guillaume Haelewyn n’a pas eu besoin de diagnostics scientifiques préalables, le doigt mouillé lui a suffi. La première année, il a d’abord ouvert ses sols pour en apprécier le compactage, Puis il a étalé 49 tonnes de fumier et 40 tonnes de déchets verts divers. « On a construit progressivement. En tout, on a quand même fait réaliser trois diagnostics de sols, en huit ans. Ça a un coût. » 65 à 80 euros l’analyse, trois à chaque fois. Sept cent vingt euros en huit ans, ce n’est quand même pas la ruine.
Au risque de déplaire ?
Chez AUREA, on fait des diagnostics depuis un demi-siècle. Habituel des débats relatifs au sol, Mathieu Valé en est le responsable scientifique. « On est un labo d’analyses dans la gestion de la fertilisation. Le nombre d’analyses a tendance à stagner, voire à diminuer, mais la typologie est identique à ce qui pouvait se faire il y a trente ans. » Les agriculteurs demandent toujours la même chose, pour gérer au mieux leur fertilisation. Pas d’informations sur la vie des sols. « La valorisation des paramètres biologiques n’est pas si simple que cela », avoue pudiquement Mathieu Valé. Les analyses de sols ne sont toujours que des outils pour « raisonner les pratiques », pour connaître classiquement les teneurs en azote minéral en sortie d’hiver. Pourtant, le sens de l’histoire semble être aux études approfondies, à la microbiologie et au comptage de vers de terre. Hormis le coût des analyses, bien plus chères que celles auxquelles procède aujourd’hui AUREA, il y a celui, prévient Mathieu Valé, de l’acceptation par le monde agricole : « Quand on bascule dans le réglementaire, les analyses risquent d’être perçues comme des sanctions, et les agriculteurs feront le strict minimum. » Effet pervers de la bonne intention : ce n’est pas parce qu’une idée est bonne qu’elle sera appliquée, c’est d’abord parce que les intéressés l’ont comprise et la diffusent. Autrement, ils la voient comme un emmerdement venu d’en haut, et feront en sorte d’en faire le moins possible, au moins cher, juste pour rester dans les clous. « Il faut qu’il y ait l’accompagnement : dès qu’on va imposer des mesures, s’il n’y a pas incitation, de l’Etat, des filières, ça ne servira à rien. Et pour nous, pour pouvoir vendre nos analyses il faut que nos clients comprennent l’intérêt de nos analyses. » Il y aurait comme un gros besoin, encore, toujours, de formations, de remises à niveau. Ce n’est pas gagné, alors que la directive-cadre européenne sur les sols sera sans doute votée cette année, et qu’elle imposera des analyses biologiques et physico-chimiques de sols. La sénatrice Nicole Bonnefoy avait voulu préparer le terrain l’an dernier en présentant un projet de loi sur la santé des sols : la plupart des syndicats agricoles ont œuvré à ce que les sénateurs votent non.
Las, un jour la directive cadre sera votée, et elle sera traduite en droit français. L’INRAE s’y prépare et pour le faire savoir, il a publié le 20 novembre 2024 les résultats d’une étude collective sur les indicateurs les plus pertinents, Indiquasols. Dix-neuf chercheurs issus de dix organismes de recherche et d’enseignement supérieur français et canadien ont travaillé à cette somme de près de 1000 pages (!) durant deux ans. Un état de l’art, financé par l’ADEME, l’OFB et les ministères en charge de l’Environnement et de l’Agriculture « C’est une approche positive, car on a considéré les fonctions écologiques des sols, et pas les menaces de dégradations des sols comme on voit souvent, » résume Alain Brauman, président de l’Afes. Sous la direction d’Isabelle Cousin (INRAE), Maylis Desrousseaux (École d’urbanisme de Paris) et Sophie Leenhardt (INRAE), les chercheurs ont défini six fonctions écologiques : supporter la biodiversité, entretenir la structure du sol, réguler l’eau, réguler les contaminants, fournir des nutriments à la biocénose [l’ensemble des âtres vivants dans un habitat] et stocker du carbone. Une cinquantaine d’indicateurs ont été étudiés (« on avait fait une liste de 427 ! » au départ, se souvient Alain Brauman). La moitié a été considérée comme mature, car ces indicateurs ont fait leur preuve depuis près de 20 ans. « Un quart est encore en maturation car non encore standardisé et un autre quart est encore au stade de la recherche. » Une bonne partie est déjà mesurée par le Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS). 50 indicateurs sont donc proposés aux agriculteurs, aux chambres, aux élus pour qu’ils décident. C’est trop. Combien en faut-il pour savoir ? Peu. « Moi j’en utilise six », avance Harmonie Brissaud, chargée de mission du groupe Eiwa, qui réunit les coopératives Sagnes, Rhizobiome et Kairos compensation.
Ethnopédologie
Harmonie Brissaud est la cheville ouvrière du Rés’eau sols, qui forme aux sols agriculteurs, maraîchers et forestiers dans un labo, le Pecnot’Lab (sic) et sur le terrain, en compagnie de chercheurs. Sans compter les MOOC, les vidéos et les webinaires « On existe depuis 2014 et on a déjà formé 180 agriculteurs », essentiellement dans le département du Tarn. Le réseau a acquis une forte réputation, pourtant, on entend comme un bémol. Il forme des paysans, mais quels paysans ? A priori pas que les exploitants déjà en transition – écologique, signe que les temps changent, que les agriculteurs les plus réfractaires à l’écologie se soucient de l’érosion de leurs parcelles. Mais voilà « un moment on se pose la question : on fait tout cela pour eux, ou pour nous ? » Le paradoxe du formateur qui finit par ne plus remarquer qu’il élabore ses projets pour lui et ses pairs, pour se satisfaire intellectuellement en oubliant les praticiens à qui ses formations sont censées être destinées. Saine interrogation qui oblige à la remise en cause.
Et a incité le groupe Eïwa à piloter le projet Soil’Lab, proposé par l’ADEME. Développer l’usage des indicateurs de santé du sol pour réussir à combiner production de biomasse et conservation des sols : approche pluridisciplinaire et transversale, voilà son titre. Une sorte d’état des lieux nécessaire, selon l’ADEME, « pour faciliter les transitions agroécologiques à plus grande échelle, il est nécessaire à la fois de promouvoir une approche réellement fonctionnaliste de la santé des sols tout en mettant en cohérence les initiatives locales. » Harmonie Brissaud va donc passer au crible une quinzaine de campagnes de mesures de la santé des sols conduites à la manière des sciences participatives (chercheurs et agriculteurs réunis). « L’un des objectifs est de récupérer toutes les données produites pour les rendre interopérables, et construire des référentiels sûrs. » Un autre volet du projet, plus sociologique, est mené par l’anthropologue Lola Richelle, post-doctorante à l’IRD. La chercheuse était intervenue lors d’un webinaire C dans l’sol en juin 2022 pour expliquer ses travaux, conduits en Espagne : elle avait passé des mois avec des agriculteurs, les observant, les écoutant surtout parler de leurs métiers, étudiant leur vocabulaire. « Ma conclusion est que si l’on veut avancer, il faut reconnaître en tant que telles les différentes formes de savoir et mettre en place les conditions sereines d’un dialogue pour construire un langage commun sur les sols et leur santé… Ça peut fonctionner, car on a produit là-bas, ensemble, une certaine vision des sols, liée à leurs pratiques, en partant de leurs gestes, de leurs connaissances à eux. » Avec tout cela, le monde agricole devrait avoir accès à des outils, des tutoriels, des instruments normalisés, vulgarisés, ainsi qu’à des cadres pour bien interpréter les données.
Écouter les gens
Une démarche très lagachienne, en définitive. Philippe Lagacherie est ingénieur de recherches à l’INRAE, il est l’un des grands défenseurs des sciences participatives en France. Dans le Tarn-et-Garonne, l’Hérault, les Dombes, le Vaucluse et beaucoup en Inde, il a lui aussi fait de l’ethnopédologie, à une échelle plus vaste que celle de Lola Richelle. « On a mis en place des ateliers participatifs pour qu’ils dégagent leurs propres typologies des sols, on les leur a fait aussi localiser sur leurs parcelles. » L’important est de ne pas donner au départ aux paysans des critères de discrimination, afin de ne pas les influencer. On laisse parler, on note, « en ne prenant pas tout ce qu’ils disent pour argent comptant. Nous avons notre connaissance académique, on utilise les deux, ensemble. » C’est en Inde où Philippe Lagacherie a conduit sa démarche jusqu’au bout. « Il y a deux façons de faire les choses : on construit un protocole et on forme les gens à l’utiliser, ou bien, c’est ce qu’on a fait en Inde, on part de la connaissance des gens telle qu’elle est, sans la forcer dans un moule. » Du terrain arrive le protocole. Et des façons de verbaliser les sols qui ne sont pas moins cohérentes que les protocoles des chercheurs.
Philippe Lagacherie en a conçu quelques idées pour rendre les diagnostics acceptables. « Si on veut que les études pédologiques soient appropriées par les gens, il faut que les gens soient associés, » par exemple lors de débats consensuels au cours desquels on les ferait jouer avec les pondérations sur les différentes fonctions des sols, afin de trouver, ensemble, ce qu’il faut mesurer, et pour quoi. Bref, jouer ensemble avec les 50 indicateurs récemment trouvés par l’INRAE dans son étude Indiquasols afin d’en conserver une collection pertinente à l’échelle de l’action collective. Il y a aussi un enjeu avec la représentation des données. Qui sait lire une carte pédologique ? Déjà… une carte… « On a lancé une enquête auprès des décideurs qui nous ont dit préférer une carte un petit peu agrégée juste pour diminuer l’incertitude locale, car ils n’ont pas besoin d’avoir un point précis à très petite échelle. » Autrement dit, une carte adaptée à la façon de décider. Entre le 1/250000e et le plan de cadastre, il y a de quoi trouver la bonne échelle.
SPIR, substitut technique ?
Voilà qui intéresse Isabelle Gattin, directrice de l’unité de recherches Aghyle (Agroécologie, Hydrogéochimie) à Unilassalle, l’école d’agro de Mont-Saint-Aignan, au nord de Rouen. Cette spécialiste de la nutrition des plantes travaille avec les capteurs. « On voit bien que les agriculteurs sont freinés par le coût des analyses de sols, or, la spectrophotométrie infrarouge proche peut les aider. » La specto IR, ou SPIR, a déjà fait ses preuves au champ, notamment pour le contrôle et l’analyse en temps réel de l’ensilage, du fumier et du lisier. En laboratoire, elle permet de recueillir une grande variété de paramètres, tels que le carbone organique, la capacité d’échanges cationiques, la biomasse microbienne ou encore l’activité enzymatique. La SPIR aspire à analyser directement les sols. Dans un document publié par Arvalis en 2029, on peut lire de grands espoirs : « Aujourd’hui, la SPIR, [qui] offre plusieurs avantages – elle est non destructive, ne requiert aucun traitement chimique, donne un résultat quasi instantané et reste facile à utiliser (…) couplée à une analyse de laboratoire, permettrait de caractériser une parcelle, de la cartographier, de contrôler sa variabilité ou d’optimiser les apports d’engrais directement en sortie du champ. » Plus besoin de sortir la tarière, un bon capteur IR suffirait ? « On peut arriver demain à avoir une signature spectrale des sols, de chaque parcelle », qu’elle soit fournie par des capteurs embarqués sur les tracteurs, des drones ou des satellites. Ou tout à la fois. « Ça permettrait un suivi plus régulier, et aussi, sans doute, ça pourrait être un levier pour faire sauter des verrous sur la prise de risque, » avec une marge d’erreur qui selon Isabelle Gattin, est moindre que celle de la tarière, dont la variabilité des résultats est importante. Mais une marge financière plus étroite, au vu du coût des matériels.
Par Frédéric Denhez