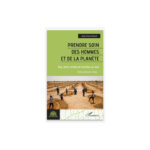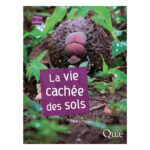2nd Colloque SRP Sols – Dôme de Caen – 2 décembre 2024
Synthèse de la Table ronde
Rédaction : Agnes GOSELIN (AFES) et Clément DESCARPENTRIES (AFES) sur la base des prises de notes des étudiantes du M2 IMST : Elébane QUERO–SERVAN, Romane GALLANTI et Coline MOREAUX
Objectif : Comprendre comment acquérir, capitaliser et rendre accessibles (pour le grand public ou pour faire des articles scientifiques) les données mobilisées dans les projets de sciences et recherches participatives.
Mots clefs : Réseau, mutualisation, « faire avec », accompagner et former aux protocoles, suivre et assurer un retour
_____
Intervenants :
– Daniel CLUZEAU, Enseignant-Chercheur : Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT)
– Apolline AUCLERC, Maître de Conférences : QUBS / JARDIBIODIV,
– Harmonie BRISSAUD, Chargée de mission : Res’eau sol
Grands témoins :
– Antonio BISPO, Directeur Unité Info&Sols, INRAE
– Romain JULLIARD, Directeur Unité de service Mosaic, Méthodes et Outils pour les sciences participatives – Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
Méthodologie : Sophie RAOUS (Directrice de l’AFES) anime cette table ronde en posant aux invités, des questions communes et des questions spécifiques. Il est alors possible de mieux cerner les similitudes, les différences, les freins, les résultats et apprentissages, les points d’attention et les clés de réussite pour les projets SRP présentés.

Crédit photos : Antoine Gutowski
Résumé des prises de paroles des invités et de leurs projets
-
Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT) avec Daniel CLUZEAU
L’OPVT a pour objectif de donner des informations nationales sur les différentes communautés lombriciennes. Ce programme a été réalisé à la demande d’agriculteurs en recherche d’outils d’autoévaluation de leurs sols. Les porteurs de projets, avec l’appui du MNHN, ont proposé des formations pour développer un protocole. Ce programme a débuté en 2011, avec un premier protocole proposé aux publics agricoles. En 2013, le retour des agriculteurs, ayant testé le 1er protocole, a permis aux chercheurs de faire des adaptations afin de faciliter l’ utilisation des protocoles et permettre ainsi leurs applications aux systèmes urbains et ruraux.
Résultats En 2014-2015, des prélèvements dans des jardins parisiens ont montré qu’ils abritent en réalité une grande diversité. En 10 ans, l’OPVT recense 10 000 données : 5000 données contributives et 5000 collaboratives, dont une moitié en co-construction et l’autre en pratique. En collaboration avec la Région Bretagne, l’OPVT développe un projet de réalisation d’atlas régionaux de la diversité lombricienne.
Freins ? Les agriculteurs trouvaient le premier protocole trop difficile. Ils étaient demandeurs d’autres types de connaissances (ex : structures du sol). En parallèle, du point de vue financier, les financeurs nationaux étant difficiles à recruter, l’OPVT se tourne vers les financeurs locaux, notamment avec les Conseils Régionaux de Bretagne. Cela a ainsi permis de créer le programme “sol de bretagne”, dont la 4ème version a été déposée cette année (2024).
-
QUBS / JARDIBIODIV, avec Apolline AUCLERC
Les invertébrés terrestres, souvent négligés, nécessitent des études approfondies, notamment à travers des cartographies en milieu urbain. Les programmes QUBS et Jardibiodiv visent à observer ces organismes et à identifier les espèces grâce à des clés de détermination.
Résultats Jardibiodiv, créé en 2017 par Mme AUCLERC, a mobilisé divers participants, principalement des enseignants et jardiniers. Les biais observés dans les sciences participatives ont conduit à des adaptations des protocoles notamment via la création, en 2020, d’une application mobile avec l’INRAE de Bordeaux pour faciliter la collecte de données. 7 ans après le lancement, Jardibiodiv, c’est 2100 observations (1438 pots pièges laissés 7 jours), plus de 62.000 individus recensés, répartis dans une vingtaine de groupes d’invertébrés par plus de 230 participants connus.
QUBS, lancé en 2022 en collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et d’autres partenaires. En 2 ans, Qubs c’est 683 sites d’observations, 438 participant-e-s et 4022 invertébrés identifiés. Un forum sur le site de QUBS favorise les échanges entre participants, renforçant leur engagement.
Être proche des participants permet le partage des connaissances et favorise leur implication. Ces programmes ont également suscité des réflexions sur la présence des invertébrés en hiver (notamment dans les jardins privés ou partagés) sont désormais mieux reconnus dans les publications scientifiques, valorisant ainsi les contributions des chercheurs et des participants.
-
Res’Eau Sol, avec Harmonie BRISSAUD, chargée de mission – animatrice res’eau sol
Né en 2014 dans le Tarn, le programme Res’eau sol a pour objectif l’autonomie des agriculteurs pour analyser et comprendre leurs sols en développant leurs connaissances sur le sol, ainsi que leur esprit critique par une approche de la méthode scientifique. Pour cela un cycle de formation sur 3 ans leur est proposé. Grâce à ces formations, en plus de leur expérience de terrain, on observe la montée en compétences des agriculteurs. Si au départ, l’intention du projet était de rassembler les agriculteurs locaux et les élus, la cible est désormais restreinte aux seuls agriculteurs. Res’eau sol regroupe actuellement 180 agriculteurs en Occitanie.
Faire ensemble : une récolte et analyse des données avec les participants. Les agriculteurs récoltent les données sur le terrain à l’aide des kits, mais sont également invités à venir en laboratoire pour les analyser. Les données sont ensuite compilées dans un tableau excel. Après l’analyse des résultats, Harmonie Brissaud prépare des graphiques qui sont présentés dans le cadre d’un bilan annuel, où tout le réseau est invité. Grâce à l’anonymisation des résultats, chaque groupe de travail peut les discuter, essayer de se situer dans les graphiques et comprendre la nature de son sol. Ensemble, ils peuvent dialoguer entre eux pour voir comment améliorer leurs pratiques. Cela permet ainsi différents niveaux de partage. L’action collective permet de s’accompagner les uns et les autres et ainsi se motiver. Depuis 10 ans, 5000 données ont été collectées.
Freins ? Les principaux coûts du programme sont la recherche de financement et l’animation, plutôt que l’analyse des données en laboratoire. Concernant la récolte de données, Res’eau sol avait initialement développé une application sur le site Rhizobiòme. Cet outil complétait les outils créés jusqu’à présent et avait une réelle vocation de simplifier la récolte des données. Finalement, cet outil n’était pas adapté au public visé car l’utilisation du numérique était pénalisant pour les agriculteurs : inaccessibilité d’une tablette ou d’un téléphone sur le terrain. Avec ce retour d’expérience, Res’eau sol propose maintenant des kits papier permettant aux agriculteurs de faciliter leurs prélèvements.
Les clés de réussites pour les intervenants :
- Faciliter le dialogue et co-construire les protocoles entre chercheurs et public cible
- Construire des protocoles attractifs, intuitifs, opérables
- Adapter le protocole au milieu d’étude
- Être proche des gens pour faciliter leur implication et former les participants
- Former les participants
- La pratique collective permet un accompagnement de chacun par ses pairs
- Assurer un retour aux participants
- Mutualiser les données participerait à une pérennisation du travail de groupe
- Viser la démonstration de la biodiversité
- Valoriser les données recueillies dans des atlas régionaux
- Maintenir la visibilité des donnés grâce aux réseaux
- Faire des ponts entre SRP et les pratiques académiques des chercheurs
- Viser la reconnaissance de la validité des SRP
-
Antonio BISPO & Romain JULLIARD
La reconnaissance et la prise en compte des données issues des projets SRP posent une question de Recherche. Les résultats de programmes de SRP pourraient être intégrés à une banque de données dans le GIS SOL en l’adaptant. D’autant que les données de biodiversité sont peu représentées.
Il faut cependant du temps pour obtenir à la fois l’autorisation des laboratoires et l’autorisation des citoyens. A savoir que “Pour des besoins de recherche, on peut intégrer des données collectées dans un but sans que l’autorisation de les utiliser pour un autre but n’ait été demandée au départ.”
Il faut consolider la confiance vis-à-vis des résultats obtenus dans les projets SRP et pour cela il faudrait pouvoir s’assurer que l’observateur a bien suivi les règles et les processus décrits précisément dans les protocoles.
Les protocoles SRP seraient valorisables pour répondre à la loi de surveillance des sols.
Points de vigilance :
- Afficher les intentions, les processus, les usages, le challenge pour les participants
- Afficher un protocole précis
- Par l’animation, faciliter des réseaux de participants (intermédiateurs) pour renforcer le sentiment d’appartenance des participants collecteurs de donnée